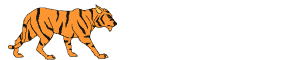Reportage sur le Jardin Zoologique de la Tête d'Or (Lyon).
Comment montrer, aujourd’hui, des bêtes en captivité ? Dans quel but ? Ecolos, les zoos repensent leur mission et leur scénographie de la nature. Reportage à Lyon, dans l’un des plus anciens d’Europe.
Vide mais menaçante, elle trône au cœur du parc de la Tête d’or, avec ses hauts barreaux aux griffes pointées vers l’intérieur. Le zoo de Lyon a conservé cette cage pour sa «valeur patrimoniale», comme un vestige de l’architecture animalière, un symbole des ménageries d’antan et du regard porté sur les «bêtes féroces». Ce modèle de 1892, interdit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a perduré à Lyon : un ours brun y a vécu jusqu’en 1993, au grand dam d’associations qui signaient pétition sur pétition pour l’en sortir. Aujourd’hui, la cage choque d’autant plus que, à l’instar de la majorité de ses homologues, le zoo lyonnais a entamé sa mue.
Autrefois pilleurs de nature, «montreurs» de fauves, les jardins zoologiques repensent aujourd’hui la présentation des animaux à un public soucieux d’écologie. A l’heure de la nouvelle grande phase d’extinction des espèces, ils se convertissent non seulement en arches de Noé, mais aussi en lanceurs d’alerte pour une biodiversité menacée.
Pister les signes de mal-être
Créé en 1858, le zoo de Lyon, l’un des plus anciens de France, était resté à la traîne. Il vit aujourd’hui, «en accéléré, la transformation que connaissent les zoos européens depuis les années 80», témoigne Eric Plouzeau, le jeune vétérinaire qui en a pris la direction en 2001. Une révolution culturelle catalysée par la création, l’an dernier, de la «plaine africaine», trois hectares précurseurs sur les six qu’occupe le zoo. Collines paysagées, grands étangs et petits îlots forestiers où se côtoient girafes, zèbres, antilopes, pélicans et flamants roses. Désormais, la priorité va au bien-être des animaux, à "l'enrichissement de leur milieu de vie", comme l’impose la directive européenne «Zoos» de 1999, transposée en 2004 dans le droit français. Finis les cages et enclos bétonnés, place à une nouvelle mise en scène de la nature.
Du belvédère, le visiteur peut contempler la savane, le grand marécage et la forêt tropicale. «On ne montre plus les animaux seuls, mais associés à une évocation de leur écosystème et à d’autres animaux», explique Eric Plouzeau, qui a exercé au sein du Muséum national d’histoire naturelle, et a collaboré au film le Peuple migrateur. «Mais cela reste un décor de théâtre, avec des plantes de pépinières et des animaux nés en captivité. Ce n’est pas un biotope naturel, sauf pour les poules d’eau ou les grenouilles !» D’accord, mais où sont donc les vedettes? «Il est midi, il fait chaud. Les girafes, les zèbres et les watusis sont allés s’abriter sous les arbres. On ne contrôle pas les animaux, le visiteur doit accepter de ne pas les voir à tout instant.»
Jusqu’à l’an dernier, les girafes vivaient dans un blockhaus de béton bordé d’un petit enclos. Leur nouvelle maison est un grand bâtiment, en forme d’ellipse, palissé de mélèze. Un bois imputrescible ne nécessitant aucun traitement chimique, «issu de forêts certifiées européennes : défendre la biodiversité animale, c’est aussi donner l’exemple en refusant les bois exotiques». A l’intérieur, où flotte l’odeur forte des girafes, l’alliance du bois et des baies vitrées procure fraîcheur et lumière tamisée. De la poutre maîtresse descendent des filets pleins de luzerne et de foin, pour «recréer les conditions physiologiques d’alimentation dans la nature». Les girafes sont-elles plus heureuses dans ce décor si bien pensé et léché ? «Le bien-être animal, c’est LA question préoccupante, reconnaît Eric Plouzeau, et l’un des objectifs fixés par la directive zoos . Ma génération n’a heureusement pas connu les prélèvements dans la nature : les 130 animaux de la plaine africaine sont tous nés en captivité et sont donc habitués à une vie dans un espace fini, avec des visiteurs.» Mais comment évaluer leur bien-être ?
Longtemps, le seul critère a été leur prolificité. Mais on sait aujourd’hui que la plupart des espèces se reproduisent en captivité. «Nous prenons donc en compte une batterie de critères conjuguant deux approches. Une approche éthologique, basée sur l’observation de chaque animal : on comptabilise le temps passé pour chaque activité (manger, jouer, épouiller…) et on compare avec ce que l’on sait du comportement de l’espèce dans la nature. On peut alors coter les comportements en captivité : anormaux, stéréotypés, atypiques. L’autre approche est d’ordre clinique : des vétérinaires pistent les signes de mal-être, les indices de stress, comme l’accélération de la respiration. Mais c’est sûr qu’avec la girafe, animal vraiment peu expressif qui passe huit heures à manger, huit à ruminer et huit à dormir par tranches de vingt minutes, on n’est pas aidé !» Cependant, l’abus d’attentions nuit. «On donne souvent aux animaux toute l’alimentation dont ils ont besoin en une fois alors que, dans la nature, leur temps est consacré à la recherche de nourriture.» Alors, pour éviter que les ours à lunettes succombent à l’ennui, les animaliers cachent dans leur enclos arboré des fruits, du riz et du miel. Autant d’efforts dont Eric Plouzeau connaît les limites : «Que dira-t-on dans quatre-vingts ans des conditions de vie des animaux dans les zoos en 2007 ?»
Echange planifié d’animaux :
En parallèle, les zoos poursuivent l’autre mission qui leur incombe depuis la fin des années 80 : participer à la conservation des espèces menacées. Certains expérimentent, avec des organismes scientifiques, une voie d’avenir : la congélation de sperme et d’embryons, dans un but de préservation de la diversité génétique des espèces et de reconstitution ultérieure de populations, même à partir d’un faible nombre de géniteurs. «Mais il faut d’abord parvenir à maîtriser les techniques de réimplantation in utero et connaître parfaitement le cycle de reproduction des mammifères.»
En attendant, les Programmes européens d’élevage, mis en place en 1985 par l’Association européenne des zoos et aquariums, constitue le socle de cette mission de sauvetage. Ils visent à maintenir, pour chaque espèce menacée, une population «de sécurité» d’au moins 250 individus. «Un coordinateur européen est nommé pour chaque espèce. Il applique les théories génétiques et démographiques pour calculer les meilleurs appariements possibles afin d’éviter la consanguinité. Il dispose pour cela des stud-books ces livres qui consignent pour chaque animal né en captivité l’identité de ses ascendants et descendants…» Une fois par an, une conférence internationale réunit directeurs de zoos et coordinateurs pour organiser les échanges d’animaux, planifier la reproduction… Ainsi, pour former un groupe social cohérent autour des deux girafes du zoo lyonnais, Eric Plouzeau a demandé un mâle et une ou deux femelles. Elles doivent arriver cet automne.
Grâce à ces programmes d’élevage, qui concernent 160 espèces, certaines, comme les tigres de Sibérie, sont désormais plus nombreuses en captivité que dans la nature, et 14 auraient été sauvées de l’extinction totale. Mais pourquoi conserver dans les zoos des espèces en péril dans leur milieu naturel ? «On n’aurait pas l’idée de poser cette question à propos d’une poterie précolombienne. Les zoos sont dépositaires d’une énorme valeur patrimoniale.»
Les programmes d’élevage peuvent aussi permettre des réintroductions dans le milieu naturel. Opérations complexes couronnées de succès : le bison d’Europe, l’oryx d’Arabie au Maroc, le tamarin lion au Brésil. Ou encore le cheval de Przewaslki, qui avait quasiment disparu d’Asie centrale : des hordes reconstituées dans les Cévennes, à partir de descendants nés en zoo, ont été relâchées en Mongolie en 2004. Mais pour réintroduire une espèce, «encore faut-il que son écosystème ait été préservé - ce qui n’est plus le cas par exemple pour les grands singes - ou que les menaces aient cessé. On voit à quel point c’est complexe avec la translocation des ours slovènes dans les Pyrénées».
L’effort des zoos reste malgré tout une goutte d’eau en matière de conservation. «Sur les 7 850 espèces animales menacées listées par l’Union internationale de conservation de la nature, les zoos ne peuvent s’occuper que de 500 au maximum. Les vrais enjeux de la conservation se jouent dans les écosystèmes d’origine et la préservation de ceux-ci.» Certains zoos s’investissent donc aussi sur le terrain, en collaborant avec des ONG ou des organismes scientifiques locaux. Vingt et un zoos français regroupés dans une association créée en 1997 par Jean-Marc Lernould, l’ancien directeur du zoo de Bâle, soutiennent ainsi scientifiquement et financièrement 24 projets de conservation d’espèces dans leur milieu naturel. Juste retour des choses : les animaux en captivité viennent ainsi à la rescousse de leurs lointains cousins sauvages. Et, dans leurs zoos, ils témoignent des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Ainsi, ces lémuriens, tout alanguis sous les arbres, corps entremêlés pour la sieste dans la petite île qui leur est réservée dans la plaine africaine, évoquent la destruction de leur habitat, la forêt primaire de Madagascar.
Des visiteurs moins agressifs :
Pour sensibiliser le public aux questions environnementales, le zoo de Lyon n’a pas hésité à innover. En créant notamment l’an dernier un «centre de récupération des tortues de Floride». «Il s’est vendu dans les animaleries françaises des milliers de ces tortues d’eau douce originaires des marécages du Mississippi. Quand elles grossissent, les propriétaires s’en débarrassent dans le Rhône ou dans les étangs des Dombes.» Leur prolifération met en péril la survie des cistudes, seules tortues aquatiques «autochtones», et leur commerce a donc été interdit en 1997. Dans le vaste étang du zoo lyonnais, chacun peut venir déposer sa tortue, même anonymement. En un an, 600 ont déjà été récupérées, que les animaliers ont empêché de proliférer en détruisant leur ponte. A ces tortues qui peuvent vivre plusieurs décennies, on offre ainsi une fin de vie confortable et sans impact sur les milieux naturels, tout en initiant les visiteurs à la problématique des espèces invasives…
Le zoo change, et ses visiteurs aussi. «Dans tous les zoos, on constate des actes de malveillance sur les animaux, comme des jets de pierres. Mais, depuis que la primaterie a été réhabilitée en huit loges spacieuses et végétalisées, ces agressions ont cessé. Comme si, lorsque le professionnel respecte plus l’animal, il induit aussi ce respect chez le visiteur.» Les jardins zoologiques, accusés dans les années 70 de n’être que des prisons pour animaux, ont donc un bel avenir comme outil d’éducation et de sensibilisation. «Il y en a partout sur la planète, souligne Eric Plouzeau, même si, à Ouagadougou, ce sont les canards européens qui jouent les animaux exotiques !»
Source : Libération,
http://www.liberation.fr
Forum
Reportage sur le Jardin Zoologique de la Tête d'Or (Lyon).
1 message
• Page 1 sur 1
Reportage sur le Jardin Zoologique de la Tête d'Or (Lyon).
Galerie Flickr : http://www.flickr.com/photos/maxime-passionzoos/
Galerie Facebook : http://www.facebook.com/PhotosAnimalier ... hue?ref=hl
Galerie Facebook : http://www.facebook.com/PhotosAnimalier ... hue?ref=hl
- maxime
- Messages: 6100
- Enregistré le: Mercredi 27 Juillet 2005 16:31
- Localisation: Vendée (85)
1 message
• Page 1 sur 1
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités