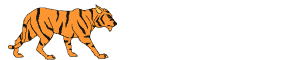Panda roux, tamarin, orang-outan... Comment les zoos protègent les animaux menacés
Dans les zoos, les techniques d’élevage des espèces sauvages menacées se sont améliorées. En plus de la conservation ex situ, ils se tournent de plus en plus vers la protection des animaux dans leur milieu naturel. Certaines espèces, comme l’oryx d’Arabie et le tamarin lion doré, ont même été réintroduites.
En janvier 1989, Reporterre publiait un article intitulé « L’arche du troisième millénaire ». À cette époque, le journaliste s’intéressait aux programmes et aux techniques de conservation ex situ — en-dehors du milieu naturel — des espèces menacées, lancés quelques années plus tôt. Trente ans après, Reporterre fait le bilan : ces programmes ont-ils tenu leurs promesses ? Surtout, ont-ils rempli leur objectif ultime, la protection des espèces dans leur habitat naturel et la réintroduction des individus captifs ?
Paris, reportage.
En ce mercredi après-midi, sous le chaud soleil printanier, c’est l’heure de la sieste pour la plupart des animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Le binturong, petit mammifère arboricole originaire d’Asie du Sud-Est à l’épaisse toison grise, dort blotti dans sa cabane, indifférent aux groupes d’écoliers qui l’observent avec curiosité. Le tamarin lion doré, un petit singe au pelage roux flamboyant, s’est caché dans les plantes et les buissons qui agrémentent sa cage. Le gaur, le plus gros bovidé du monde, rumine paisiblement. Le martin de Rothschild, un grand oiseau blanc à l’élégant sourcil bleu, reste désespérément silencieux.
Ces différentes espèces ont un point commun : toutes sont en danger dans leur milieu naturel et font l’objet d’un programme de « conservation ex situ ». « La conservation ex situ a été définie en 1992 dans la Convention sur la diversité biologique comme la conservation de la diversité biologique des espèces en-dehors de leur milieu naturel, explique à Reporterre Michel Saint-Jalme, le directeur de la ménagerie, également maître de conférences en biologie de la conservation au Centre d’écologie et des sciences de la conservation (Cesco). Ses outils sont les élevages conservatoires — conduits par les parcs zoologiques — et les élevages de propagation, destinés à produire des animaux pour leur réintroduction dans le milieu naturel. »
« Pour chaque espèce, un coordinateur dresse l’arbre généalogique de tous les spécimens en captivité »
Les zoos européens, via des Programmes européens pour les espèces menacées (EEP), organisent les naissances en captivité pour conserver la meilleure diversité génétique possible. « Pour chaque espèce, un coordinateur dresse l’arbre généalogique de tous les spécimens en captivité, le ‘‘studbook’’, pour remonter jusqu’aux ancêtres sauvages, appelés ‘‘fondateurs’’, décrit M. Saint-Jalme, lui-même coordinateur pour l’oryx d’Arabie, un ongulé asiatique. Puis, chaque année, aidé par un comité d’espèce, il émet des recommandations pour la reproduction et les échanges entre zoos. L’idée est d’égaliser la représentation des gènes de chacun des fondateurs, pour éviter la dérive génétique. »
L’objectif est préserver 90 % de la diversité génétique sur cent ans. Défi atteint pour les orangs-outans de Bornéo qui vivent dans la ménagerie : « On considère qu’il faut entre vingt et cinquante fondateurs indépendants pour conserver 99 % de la variabilité génétique d’une espèce. Aujourd’hui, nos orangs-outans, issus de 70 fondateurs sans liens de parenté, représentent trois ou quatre générations plus tard 98,5 % de la variabilité de l’espèce. »
Le martin de Rothshild n’existe plus dans la nature, victime de trafics
Sur les 150 espèces élevées à la ménagerie, 48 font l’objet d’un de ces programmes. Un maillon d’un vaste réseau : en Europe, 355 zoos répartis dans 44 pays participent à des EEP consacré à 400 espèces différentes. Mais c’est une goutte d’eau face au risque d’extinction d’un million d’espèces dans les prochaines décennies, pointé en avril par les experts de l’IPBES. Pour choisir où concentrer ses efforts, l’Association européenne des parcs zoologiques (EAZA), qui gère les EEP, s’appuie sur la liste rouge établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Trois niveaux de menace sont distingués : « en danger critique d’extinction » quand l’espèce a une probabilité de disparaître supérieure à 50 % sur cinq ans, « en danger » pour une probabilité supérieure à 20 % en 20 ans et « vulnérables » pour une probabilité de 10 % de disparaître d’ici un siècle. « Les espèces choisies pour être conservées sont les plus menacées. En France, priorité est donnée aux espèces en danger critique et endémiques – c’est le cas du pétrel de Bourbon, endémique de La Réunion. Ou alors, les plus charismatiques : les grands mammifères, les grands oiseaux », observe Florian Kirchner, chargé d’établir la liste rouge pour la France et les territoires ultra-marins à l’UICN France.
La démarche semble bien rodée. Mais l’histoire de la conservation ex situ n’est pas si ancienne. « Les parcs zoologiques ont explosé après la Seconde Guerre mondiale, mais il s’agissait surtout de lieux de loisirs. Partout dans le monde, des compagnies capturaient des animaux sauvages pour les vendre aux zoos », raconte Michel Saint-Jalme. C’est avec la montée des préoccupations environnementales, dans les années 1970, que les zoos ont dû réfléchir à leur raison d’être.
« Après la signature de la Cites [Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction], en 1973, les zoos n’ont plus pu recourir à la capture et ont donc dû mettre en œuvre des programmes de reproduction. »
En 1972, le fondateur et directeur du zoo de Jersey, Gérard Durell, a organisé une grande conférence au cours de laquelle il a appelé les parcs zoologiques à tenir un rôle plus important dans la conservation des espèces animales menacées d’extinction. Dix ans plus tard naissaient les SSP (Species Survival Plan) américains, suivis en 1985 par les EEP européens.
En plus des programmes d’élevage, les zoos soutiennent des programmes de conservation dans le milieu naturel
Mais à quoi bon conserver des espèces en captivité si elles disparaissent à l’état sauvage ? Depuis le début des années 2000, en plus de leurs programmes d’élevage, de nombreux zoos soutiennent des programmes de conservation in situ, dans le milieu naturel. En 2017, les parcs zoologiques membres de l’EAZA ont consacré 26,8 millions d’euros et 70.000 heures de travail à ces mesures.
À la Ménagerie, de grands panneaux pédagogiques de soutien à la campagne Silent Forest de lutte contre la capture d’oiseaux chanteurs en Asie du Sud-Est ont été installés à côté de la volière des martins de Rothschild. « Cette espèce endémique de l’île de Bali a un chant extrêmement beau. De nombreux individus ont fini en cage dans des jardins et aujourd’hui le martin de Rothschild fait partie des douze espèces les plus menacées dans le monde : il n’y en a plus que 1.500 dans les zoos européens, zéro dans la nature », soupire Michel Saint-Jalme. Outre ces panneaux d’information, la campagne recueille des fonds pour des projets sélectionnés, comme le centre d’élevage Cikananga en Indonésie. « L’EAZA œuvre aussi à la constitution d’un nouveau groupe de spécialistes à l’UICN consacré au trafic des oiseaux chanteurs asiatiques et à un Mémorandum d’accord pour une collaboration plus étroite entre notre association et les ONG Traffic et BirdLife International. Elle mène un travail de reclassement de certaines espèces d’oiseaux pour leur garantir une protection adéquate et dialogue avec les institutions indonésiennes, notamment pour encourager les populations du Sud-Est asiatique à ne pas acheter d’oiseaux chanteurs quand elles ne connaissent pas leur provenance », complète David Williams-Mitchell, directeur de la communication de l’EAZA.
Pauline Kayser, soigneuse des binturongs à la ménagerie, a créé en 2014 sa propre association ABConservation pour l’étude et la protection des binturongs sauvages. « À mon arrivée, en 2011, je ne connaissais pas cette espèce et je me suis vite aperçue que mes collègues non plus. Avec Géraldine Veron, une chercheuse du Muséum national d’histoire naturelle spécialisée dans les petits carnivores, on a réalisé que les seules données provenaient des zoos, qu’aucun recensement n’avait été mené dans le milieu naturel et qu’on ne savait rien de lui, à part qu’il mangeait sûrement des figues ! Nous ne savions même pas s’il était nocturne ou diurne. »
Après plus d’un an d’enquête, l’équipe a dressé en 2015 une nouvelle carte de la répartition de cette espèce en Asie du Sud-Est. Puis, début 2017, elle a lancé un programme d’étude d’une population de binturongs sauvages repérée sur l’île de Palawan, aux Philippines. « Nous avons installé des pièges vidéo au sommet des arbres et obtenu plus de 50 images dès la deuxième année », se réjouit Pauline Kayser.
« On aide aussi les habitants à replanter des vergers communautaires et à installer des ruches »
Prochaine étape, équiper des binturongs de colliers de radio-pistage pour suivre leurs déplacements. « C’est une étape importante qui doit nous permettre d’obtenir des données sur la reproduction et de découvrir les arbres qu’ils aiment et les fruits qu’ils mangent. Sinon, comment savoir quels arbres replanter dans les forêts qui ont été déforestées ? »
Entre-temps, la vétérinaire de la ménagerie Aude Bourgeois a obtenu que le binturong, classé « vulnérable » par l’UICN en raison de la déforestation et de la vente comme animal de compagnie, fasse l’objet d’un EEP. Mais avec cette espèce, la conservation ex situ touche ses limites. Aujourd’hui, l’espèce compte seulement 125 individus en captivité répartis dans 55 zoos qui peinent à obtenir des naissances. « 25 petits nés entre 2003 et 2015 proviennent de la même femelle. Il va être très compliqué d’élever une population viable génétiquement », soupire Pauline Kayser. La conservation ex situ reste néanmoins intéressante : « Ce sont les zoos qui financent les programmes de recherche. Nous avons aussi pu tester les colliers de radio-pistage sur les binturongs d’une réserve, ce qui nous a permis de vérifier qu’ils ne poseraient pas de problème aux animaux sauvages. »
Le zoo de la Boissière du Doré près de Nantes a quant à lui ouvert en 2016 sa propre clinique vétérinaire dans la province de Naceh, sur la pointe nord de l’île de Sumatra en Indonésie. « On a embauché un vétérinaire local qui, assisté par des étudiants vétérinaires français, y soigne des animaux endémiques comme les gibbons, les binturongs, les calaos bicornes, les panthères longibandes, etc. On aide aussi les habitants à replanter des vergers communautaires et à installer des ruches, en les encourageant à protéger leur magnifique forêt », explique Sébastien Laurent, le directeur du zoo.
En outre, le parc consacre chaque année entre 40.000 et 50.000 euros à des programmes de conservation in situ. « Il s’agit d’impliquer nos visiteurs en communiquant sur le fait qu’une partie de l’entrée sert à replanter des arbres à Madagascar ou à équiper des brigades anti-braconnage en Afrique du Sud. Parce que si l’on ne fait rien, dans dix ans il n’y aura plus de rhinocéros en Afrique. »
Car l’élevage ex situ des animaux ne peut pas être une fin en soi et n’a pas vocation à se prolonger éternellement. « Même si on essaie d’éviter la dérive génétique, les animaux les plus adaptés à la captivité se reproduisent davantage que les autres. Cela risque d’aboutir à une sélection involontaire à la captivité. C’est pourquoi les programmes d’élevage ne sont pas destinés à durer 200 ou 300 ans », prévient Michel Saint-Jalme.
« La conservation ex situ est le dernier recours »
L’objectif à ne pas perdre de vue est celui de la réintroduction des animaux dans leur milieu naturel. En 2005, 489 programmes de réintroduction d’animaux étaient menés dans le monde. Une grande majorité concernait des mammifères (172) et des oiseaux (138). Michel Saint-Jalme a travaillé sur la réintroduction de l’oryx d’Arabie, l’espèce dont il est le coordinateur, qui avait totalement disparu de son dernier bastion, Oman, dans les années 1960 : « On a reconstitué un élevage de propagation en Arabie saoudite à l’aide d’individus de zoos. On les a progressivement habitués à retourner dans le milieu naturel et ce n’est qu’à la troisième génération qu’on a commencé les lâchers. » Pour préparer le terrain, une lutte acharnée contre la chasse, principale cause de la disparition de l’oryx, a été menée dans les zones de réintroduction. Aujourd’hui, l’espèce n’est plus classée que « vulnérable » par l’UICN. « Il n’y a même plus de lien entre conservation in situ et élevage ex situ. C’est un modèle de programme qui a bien fonctionné », se félicite le directeur de la Ménagerie.
Le tamarin lion doré, qui ne comptait plus qu’une vingtaine d’individus sauvages dans les années 1970, a vu ses effectifs remonter à 3.000 animaux après un programme de réintroduction réussi mené en collaboration par le Brésil et des zoos américains. Pour autant, il ne faut pas inverser la fin et les moyens, prévient Florian Kirchner. « La conservation ex situ est le dernier recours. De toute façon, elle ne suffira pas car on ne dispose pas d’assez de moyens pour mener des programmes de conservation pour toutes les espèces en danger critique d’extinction – 5.000 dans le monde actuellement. Il faut agir avant, en préservant les populations pérennes dans leur espace naturel et protéger les espaces en créant des parcs et des réserves, parcs et sanctuaires marins. Et surtout, lutter contre les destructions : l’agriculture intensive et ses grandes monocultures arrosées de pesticides à haute dose, l’urbanisation et les grands projets pas toujours pertinents, la surpêche. Arrêtons de détruire, comme ça on n’aura plus à se dire qu’on n’a pas les moyens de tout conserver. »
.